Le ROI pour la GED RH offre une réponse concrète et chiffrée. Il ne s’agit pas seulement de justifier un budget, mais aussi de piloter le projet avec précision, en identifiant les leviers de gains les plus pertinents et en évitant les pièges courants. Un calcul de ROI bien mené permet de comparer objectivement les solutions disponibles, de prioriser les fonctionnalités les plus impactantes, et surtout, de mesurer l’efficacité réelle du déploiement une fois la GED en place.
Le ROI, ou Retour sur Investissement, est traditionnellement perçu comme un indicateur financier. Pourtant, dans le cadre d’une GED appliquée aux RH, sa portée est bien plus large. Il s’agit d’évaluer l’impact global de la dématérialisation sur des processus métiers critiques, tels que la gestion des dossiers salariés, l’automatisation des workflows, ou encore la conformité réglementaire.
Contrairement à d’autres projets IT, la GED RH touche directement des activités quotidiennes et stratégiques : la gestion des contrats, des bulletins de paie, des évaluations, ou encore des demandes de congés. Son ROI ne peut donc se limiter à une comparaison entre coûts et économies. Il doit aussi intégrer des bénéfices qualitatifs, comme l’amélioration de l’expérience collaborateur, la réduction des risques juridiques, ou encore le renforcement de l’image employeur.
Les gains quantitatifs sont ceux que l’on peut mesurer directement : réduction des coûts de stockage physique, économies de temps, diminution des erreurs administratives. Ces éléments sont essentiels pour construire un business case solide. Cependant, les gains qualitatifs, bien que moins tangibles, sont tout aussi stratégiques. Une solution de GED RH bien déployée peut, par exemple, améliorer la satisfaction des collaborateurs en leur offrant un accès instantané à leurs documents, ou renforcer la conformité en automatisant les processus d’archivage.
Pour être complet, le calcul du ROI doit donc combiner ces deux approches, en s’appuyant sur des données concrètes pour les gains quantitatifs, et sur des indicateurs indirects (enquêtes, audits) pour les gains qualitatifs.
Avant de parler de gains, il est impératif de dresser un inventaire exhaustif des coûts liés à la mise en place et à l’exploitation de la GED pour les Ressources Humaines. Ces coûts se répartissent en deux grandes catégories, souvent sous-estimées dans les premières estimations.
Une fois les coûts identifiés, il convient d’analyser les bénéfices apportés par la GED. Ceux-ci peuvent être classés en deux catégories : les gains directs et mesurables, et les gains indirects ou stratégiques.
Les gains quantitatifs sont ceux qui impactent directement le bilan financier ou opérationnel de l’entreprise. Parmi les plus significatifs, on trouve la réduction des coûts de stockage physique (moins de locaux dédiés aux archives, moins de fournitures de bureau), les économies de temps réalisées par les équipes RH et les managers (moins de temps passé à rechercher ou traiter des documents), la diminution des erreurs (documents perdus, doublons, saisies erronées), et l’automatisation des tâches répétitives (envoi automatique des bulletins de paie, relances pour les évaluations, etc.).
| Exemple concret : Une entreprise qui automatise la gestion des demandes de congés peut réduire de 30 % le temps consacré à cette tâche par les services RH, soit l’équivalent de deux emplois à temps plein économisés sur l’année. De même, la suppression des archives papier peut générer des économies annuelles de plusieurs milliers d’euros, selon le volume de documents concerné. |
Les gains qualitatifs, bien que moins faciles à chiffrer, sont tout aussi importants. Ils incluent l’amélioration de la conformité (moins de risques de sanctions liées à la non-conformité RGPD ou aux délais de conservation), une meilleure expérience collaborateur (accès instantané aux documents, mobilité, transparence), et une image employeur renforcée (une entreprise perçue comme moderne et innovante attire plus facilement les talents).
Pour estimer ces gains, il est possible de s’appuyer sur des enquêtes de satisfaction, des audits de conformité, ou des indicateurs de turnover. Par exemple, une baisse du taux de rotation du personnel peut être corrélée à une meilleure expérience collaborateur, elle-même facilitée par une GED performante.
Pour s’assurer que la solution GED dédiée aux RH apporte bien les bénéfices escomptés, il est essentiel de mesurer son impact de manière continue, en s’appuyant sur des indicateurs pertinents et adaptés aux enjeux RH.
Parmi les KPI (Key Performance Indicators) les plus utiles, on trouve :
| Exemple de tableau de bord : Avant le déploiement de la GED, le temps moyen pour retrouver un dossier salarié était de 15 minutes. Après la mise en place, ce délai est passé à 2 minutes, soit un gain de 13 minutes par recherche. Multiplié par le nombre de recherches effectuées chaque mois, ce gain de temps se traduit par des économies significatives en heures de travail. |
Pour gagner du temps et éviter les erreurs de calcul, plusieurs outils sont à la disposition des responsables RH. Les modèles Excel pré-remplis, par exemple, proposent des formules de calcul de ROI, des exemples de coûts et de gains types, ainsi que des tableaux de bord pour suivre l’évolution des indicateurs. De leur côté, les simulateurs en ligne permettent d’estimer rapidement le ROI en fonction de la taille de l’entreprise, du volume de documents à gérer, et des processus concernés.
Où les trouver ? Les éditeurs de logiciels GED proposent souvent des modèles ou des simulateurs gratuits sur leurs sites. Les cabinets de conseil spécialisés en transformation digitale, ainsi que les organismes comme l’APEC ou Markess by Exægis, publient également des ressources utiles, sous forme de livres blancs ou d’études sectorielles.
Pour valider ses hypothèses et identifier des axes d’amélioration, rien ne vaut l’étude de cas concrets. De nombreuses entreprises, de toutes tailles et de tous secteurs, partagent leurs résultats après le déploiement d’une GED RH. Par exemple, une PME de 200 salariés a pu réduire ses coûts de gestion documentaire de 40 % en deux ans, tandis qu’un groupe international a automatisé 80 % de ses processus RH, libérant l’équivalent de trois emplois à temps plein.
Ces retours d’expérience permettent non seulement de confirmer la pertinence du projet, mais aussi d’anticiper les écueils et d’optimiser la stratégie de déploiement.
Un bon ROI ne dépend pas uniquement de la qualité du logiciel choisi ou de la précision des calculs. Il repose aussi sur des facteurs humains et organisationnels, souvent sous-estimés.
Calculer le ROI d’une GED RH est un exercice à la fois technique et stratégique. En suivant une méthodologie rigoureuse — identification des coûts, quantification des gains, suivi des indicateurs — les responsables RH maximisent leurs chances de succès. Le ROI n’est pas une fin en soi, mais un outil de pilotage qui permet de justifier le projet, d’en mesurer l’impact, et d’ajuster la stratégie en fonction des résultats.
Une GED RH bien déployée et bien adoptée peut transformer en profondeur les processus RH, en réduisant les coûts, en améliorant la productivité, et en renforçant la conformité. Mais pour y parvenir, il faut allier rigueur financière et vision stratégique, sans jamais perdre de vue l’humain au cœur de la transformation.
Lire aussi :
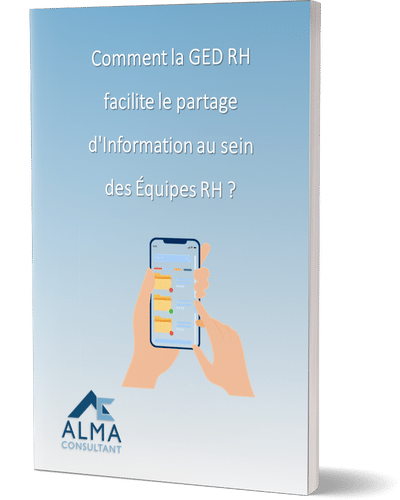
« * » indique les champs nécessaires